La politique d'une féministe américaine écrivant sur les femmes indiennes
Publié en 1990, May You Be the Mother of a Hundred Sons raconte le voyage de son auteure Elizabeth Bullimer en Inde au milieu des années 1980. Le sénateur Daniel Patrick Moynihan, ancien ambassadeur des États-Unis en Inde, la place à juste titre dans l'héritage historique des voyageurs occidentaux écrivant sur l'Inde lorsqu'il affirme : « C'est la réalisation la plus rare, un écrivain occidental qui a réellement découvert l'Inde. Ce que E.M. Forster et Ruth Jhabvala ont réalisé en tant qu'art, Elisabeth Bumiller l'a illustré en rendant compte clairement des civilisations les plus complexes de la planète. »
En tant qu'auteure écrivant sur des femmes d'une autre culture, son travail constitue une étude de cas intéressante sur les nuances, les subtilités et le développement de la philosophie et de la politique féministes.
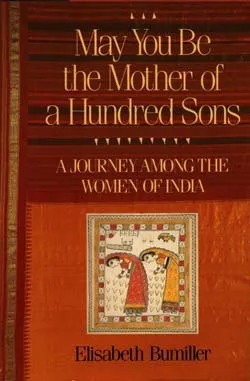
La politique du choix de voyage de Bullimer est évidente, et sa conscience de soi en la matière est consciente d'une philosophie d'identification post-moderniste méta-analytique. Elle écrit : « J'étais déjà sensible à mon statut d' « épouse » qui avait suivi son mari à l'autre bout du monde. Je ne voulais certainement pas écrire un livre féminin prévisible. »
Ce qui l'a finalement amenée à prendre la décision d'aller de l'avant, c'est la sage reconnaissance du fait que les récits d'expériences de femmes peuvent être « utilisés » comme points d'entrée culturels sur des questions d'une plus grande pertinence sociétale et politique en Inde. Tous ses sujets d'actualité (« pauvreté, surpopulation, menaces à l'unité nationale et violence religieuse ») ont en fin de compte une composante humaine qui peut être mieux exprimée par un reportage sincère sur les problèmes des femmes. Pour la citer, « je commençais à me rendre compte que les femmes étaient ma fenêtre sur le monde intérieur de l'Inde et sur les questions de famille, de culture, d'histoire, de religion, de pauvreté, de surpopulation, d'unité nationale. En fait, les problèmes mêmes que je pensais auparavant n'étaient pas liés aux préoccupations des femmes ».
Cela attire l'attention sur les débats sociopolitiques plus larges au sein de la théorie féministe et sur l'ampleur et la portée de l'étude. Il souligne également que la femme n'est pas une catégorie uniforme et universelle clairement définie, mais plutôt une composante d'une population plus large, ce qui permet un mode d'étude ethnographique d'une culture et de ses dynamiques plus larges.

Bumiller est également représentative des progrès économiques et culturels que la femme occidentale a réalisés au fil des ans. Les différences entre ses préoccupations en tant que féministe occidentale et les expériences des femmes indiennes constituent un point de données qui n'échappe même pas à son attention. Elle écrit : «... mais là, mes émotions féministes les plus passionnées étaient centrées sur la cuisine, lors de disputes avec mon mari pour savoir qui devait préparer le dîner et débarrasser la table ». Elle note également le profond fossé culturel : « Aucune femme américaine aux prises avec des difficultés familiales et professionnelles ne peut complètement imaginer ce que cela signifie en Inde ».
Le fait que Bumiller ait réussi à convaincre son agence de presse de créer une opportunité journalistique spéciale lui permettant de valider son voyage en Inde avec son mari contraste nettement avec les expériences des anciennes auteures figurant dans le canon des écrivaines de voyage féminines. En fait, la critique Susan Bassnett accorde une attention particulière à cet aspect dans sa théorisation de la littérature de voyage sous l'angle du genre. « Les femmes ont rarement été mandatées pour voyager ». Ainsi, en l'absence d'un mécène ou d'une figure d'autorité, les femmes peuvent se permettre d'être plus discursives, plus impressionnables, plus ordinaires. » La question de savoir si l'absence de figures de mécènes accroît ou restreint la liberté d'auteur mérite d'être examinée.
L'humilité de Bumiller à l'égard de la culture indienne est également plus progressive que celle de ses prédécesseurs. Bassnett note que « la théorie de la femme exceptionnelle, quelque peu différente des autres femmes et donc habilitée à accomplir des exploits (comme écrire des récits de voyage) qu'aucune femme normale ne serait capable de réaliser » est l'un des moyens classiques de représentation dans les anciens textes de voyage (c'est moi qui souligne). Ce trope divise essentiellement les femmes et les empêche de s'unir, du moins théoriquement, contre le discours patriarcal dominant.
May You Be the Mother of a Hundred Sons attire également notre attention sur la politique du féminisme intersectionnel et sur la manière dont les récits patriarcaux dominants influencent les structures de pouvoir au sein du genre féminin ou féminin. Dans son essai, « Under Western Eyes : Feminist Scholarship and Colonial Discours », la chercheuse Chandra Talpade Mohanty pose la question avec éloquence. « Ce que je souhaite analyser, c'est en particulier la production de la « femme du tiers-monde » en tant que sujet monolithique singulier dans certains textes féministes (occidentaux) récents.
La définition de la colonisation que je souhaite évoquer ici est essentiellement discursive, axée sur un certain mode d'appropriation et de codification de l' « érudition » et du « savoir » sur les femmes du tiers monde selon des catégories analytiques particulières utilisées dans des écrits spécifiques sur le sujet qui prennent pour référence les intérêts féministes tels qu'ils ont été exprimés aux États-Unis et en Europe occidentale. » Bumiller se trouve dans un discours politique où ces questions sont courantes et catégoriques, et elle en est consciente.
Elle avoue avec élégance : « Tout au long de mon voyage, j'ai toujours été consciente des limites des étrangers dans un pays étranger. Je me suis posé quotidiennement le problème des normes à appliquer. Certains journalistes occidentaux ont idéalisé l'Inde, et d'autres n'y ont vu que des éléments qui renforçaient leur propre sentiment de supériorité culturelle. »
Un point intéressant d'expérience interculturelle est la confiance des femmes indiennes en Bumiller, une étrangère. Certains d'entre eux, comme Manju et Meena, étaient plus que disposés à partager les détails de leurs expériences avec un journaliste, comme s'ils se confiaient à une sœur aînée. Il montre ensuite la pertinence d'un discours théorique féministe international malgré les particularités culturelles. Il fait allusion à la présence d'un lien féminin qui transcende les frontières nationales et est donc capable de reconnaître et de capturer l'expérience humaine dans sa vérité au-delà des paradigmes socialement construits. La différence frappante entre la conception patriarcale du voyage et la conception féministe est donc la suivante. Les premiers voyagent à la conquête de l'inconnu. Ce dernier le fait pour l'accepter.

Ouvrages cités :
Bassnett, Susan. « Rédaction de voyage et genre ». Ed. Hulme, Peter et Tim Youngs. Le compagnon de Cambridge pour l'écriture de voyage. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 225-241.
Bumiller, Élisabeth. Puissiez-vous être la mère de cent fils : un voyage parmi les femmes de l'Inde. New York : The Random House Publishing Group, 1990.
Talpade Mohanty, Tchad. « Sous les yeux de l'Occident : études féministes et discours coloniaux ». Sur l'humanisme et l'université : le discours de l'humanisme 12.3 (1984) : 333-358.
Opinions and Perspectives
J'ai trouvé fascinant la façon dont Bumiller reconnaît son propre privilège en tant que femme occidentale tout en essayant de comprendre les expériences des femmes indiennes. Sa conscience de soi la distingue vraiment des écrivains voyageurs précédents.
Le passage sur les disputes pour savoir qui devrait préparer le dîner montre un contraste frappant entre les préoccupations féministes occidentales et indiennes. Cela remet vraiment les choses en perspective pour moi.
Je ne suis pas d'accord avec la façon dont elle a abordé certains de ces sujets culturels sensibles. Parfois, j'ai eu l'impression qu'elle imposait des valeurs occidentales plutôt que de vraiment comprendre le contexte local.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont les femmes indiennes se sont ouvertes à elle malgré le fait qu'elle soit une étrangère. Il doit y avoir quelque chose d'universel dans le fait que les femmes partagent leurs histoires les unes avec les autres.
C'est intéressant de voir comment elle ne voulait pas initialement écrire un livre sur les femmes, mais a fini par considérer les histoires des femmes comme une fenêtre sur des problèmes sociétaux plus profonds.
La comparaison avec EM Forster semble un peu forcée. Son approche journalistique est complètement différente de ses récits de fiction.
J'aime la façon dont elle reconnaît les limites de l'étranger. Ce genre d'humilité était rare dans les récits de voyage occidentaux sur l'Inde à cette époque.
Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué comment elle a réussi à obtenir des aménagements spéciaux de sa société de presse ? Cela en dit long sur les progrès des femmes occidentales sur le lieu de travail.
Bien que ses intentions semblent bonnes, je ressens toujours une certaine supériorité culturelle sous-jacente dans son écriture. C'est subtil, mais c'est là.
La façon dont elle relie les histoires de femmes individuelles à des problèmes plus vastes comme la pauvreté et la surpopulation est vraiment puissante. Cela rend les problèmes abstraits plus personnels et réels.
En lisant l'histoire de la confiance de Manju et Meena en elle, j'ai pensé à la façon dont les femmes trouvent souvent des moyens de se connecter au-delà des barrières culturelles.
C'est vrai pour Manju et Meena. J'ai ressenti la même chose. C'est comme s'il y avait une sororité tacite qui transcende les différences culturelles.
L'article soulève des questions importantes sur qui peut raconter les histoires de qui. Une femme occidentale peut-elle vraiment saisir l'expérience féminine indienne ?
Sa conscience d'être l'épouse qui a suivi son mari est d'une honnêteté rafraîchissante. J'apprécie qu'elle reconnaisse cette limitation potentielle.
Le contraste entre les préoccupations féministes dans différentes cultures est révélateur. Cela me pousse vraiment à examiner mes propres hypothèses sur le féminisme universel.
Est-ce que quelqu'un d'autre trouve problématique qu'elle ait utilisé les histoires personnelles de femmes comme points d'entrée pour discuter de problèmes plus vastes ? Cela me semble un peu exploiteur.
Pas du tout exploiteur. Elle a donné une voix à des histoires qui n'auraient peut-être jamais été entendues autrement. C'est du journalisme précieux.
J'ai trouvé le cadre théorique sur les récits de voyage et le genre fascinant. Je n'avais jamais pensé que le manque de mécénat pourrait en fait donner plus de liberté aux femmes écrivains.
Le livre semble en avance sur son temps en matière de féminisme intersectionnel. Elle a vraiment essayé d'éviter le piège de traiter les femmes du tiers monde comme un groupe monolithique.
Son style d'écriture oscille entre sensibilité culturelle et objectivité journalistique. L'équilibre a dû être difficile à trouver.
La section sur les émotions féministes occidentales centrées sur les disputes de cuisine m'a vraiment touchée. Cela m'a fait réfléchir à ma propre perspective privilégiée.
Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon dont elle a réussi à maintenir le respect culturel tout en abordant des sujets difficiles.
L'approche de Bumiller semble plus nuancée que celle de nombreux auteurs contemporains sur des sujets similaires. Elle reconnaît la complexité plutôt que de simplifier à l'excès.
La façon dont elle relie les histoires personnelles à des problèmes sociétaux plus vastes me rappelle le journalisme narratif moderne. Elle était en avance sur son temps.
Je ne suis toujours pas convaincu par ses méthodes. N'aurait-il pas été préférable de soutenir les femmes indiennes qui racontent leurs propres histoires ?
Ses réflexions sur la relation entre les problèmes des femmes et les problèmes nationaux comme la surpopulation me semblent particulièrement pertinentes aujourd'hui.
Le titre même du livre témoigne d'une sensibilité culturelle. C'est une bénédiction traditionnelle qui témoigne du respect des valeurs locales.
J'apprécie la façon dont elle reconnaît à la fois la romantisation et le complexe de supériorité courants dans les écrits occidentaux sur l'Inde.
La comparaison avec les précédentes femmes écrivains voyageuses est intéressante. Elle montre comment le genre a évolué au fil du temps.
Bien dit sur l'évolution du genre. C'est comme regarder le féminisme lui-même se développer à travers les récits de voyage.


